Eric Hazan Changement de propriétaire, la guerre civile continue
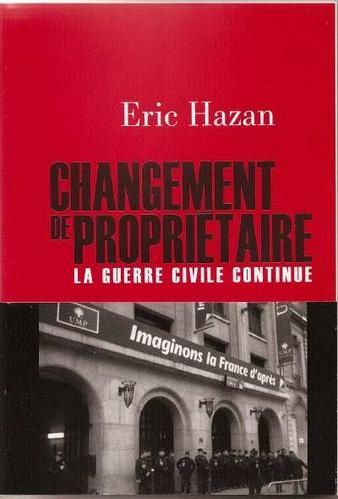
La chronique
6 août 2017
Entretien avec Jonathan Litvak, professeur d’histoire française contemporaine à l’université Noam Chomsky de Racine (Wisconsin.
Il y a dix ans, la France choisissait Nicolas Sarkozy comme président de la République. Cette élection, comme les mois qui l’ont suivie, ne ressemblait à aucune des présidentielles précédentes. À la lumière de ce qui s’est passé depuis, peut-on considérer qu’il s’agissait réellement d’une rupture, comme l’affirmait Sarkozy lui-même ?
Je ne crois pas beaucoup à la notion de rupture historique : pour moi, l’histoire ne se débite pas comme un cake, à coups de ruptures. Votre grand Braudel le disait d’ailleurs il y a bien cinquante ans. Cela dit, si l’on compare l’élection de Sarkozy et les mesures prises dans les premiers temps, avec l’intronisation de Chirac en 1995 ou en 2002, on trouve, c’est vrai, certains contrastes, qui ont pesé lourd par la suite. Commençons par les points de continuité. Je ne pense pas que Sarkozy ait fait notablement évoluer le capitalisme français. Les mutations importantes étaient déjà largement réalisées, depuis quinze ans au moins. Les mesures fiscales votées quelques semaines après l’élection n’étaient qu’une façon de remercier ceux qui l’avaient soutenu, et elles n’ont eu aucune conséquence notable. On pourrait noter en passant que l’idée de relancer l’économie en diminuant l’imposition des plus riches avait été mise en œuvre autrefois par le président Reagan, elle aussi sans aucun effet, d’ailleurs. La politique pénale de Sarkozy n’était pas non plus une nouveauté. Vous vous souvenez sans doute que dix ans auparavant, un ministre de l’Intérieur socialiste qui s’appelait Jean-Pierre Chevènement proclamait qu’il fallait éloigner de leurs quartiers les noyaux durs de multirécidivistes, créer des centres de rééducation en milieu fermé, etc. Pour lui, il l’a souvent répété, la sécurité était un concept de gauche. Le durcissement progressif de la législation sécuritaire a commencé sous des gouvernements socialistes. Les couches se sont ensuite superposées, avec une accélération après le 11 septembre 2001 sous couvert de lutte antiterroriste, en suivant notre exemple : les lois Perben s’inspiraient par bien des traits du Patriot Act, voté dans la foulée de la destruction des Twin Towers. Les lois Sarkozy-Dati étaient certes particulièrement iniques et même, pour certaines, anticonstitutionnelles, mais elles s’inscrivaient dans une continuité. Quoi qu’il en soit, contre la banlieue, le mécano sécuritaire n’a pas eu l’effet escompté, bien au contraire : les séjours en prison n’étaient plus conçus comme un stigmate mais comme une fatalité, une malchance, voire comme un titre de gloire. C’est d’ailleurs là que se sont formés bien des meneurs de l’insurrection de 2011 : de nombreux témoignages montrent que la cohabitation, derrière les mêmes barreaux, de la jeunesse politisée et de la jeunesse criminelle a eu un effet que l’on pourrait qualifier d’entraînement mutuel.
Mais en politique étrangère, la présidence Sarkozy n’était-elle pas en rupture avec l’immobilisme des années Chirac ?
Ce qui était nouveau, c’était l’agitation. Dès les premières semaines de la nouvelle présidence, Sarkozy et Kouchner, qui était alors ministre des Affaires étrangères, ont fait preuve de leurs capacités gesticulatoires depuis Berlin et Bruxelles jusqu’à la Libye, au Darfour, au Liban, et j’en passe – le tout sans résultats autres qu’anecdotiques. Mais la vraie politique étrangère est restée à peu près la même que sous Chirac : la France a continué à afficher son soutien aux pires dictatures comme celle de feu Ben Ali en Tunisie, elle a maintenu les relations les plus douteuses de la Françafrique comme avec Omar Bongo au Gabon par exemple, elle a appuyé la politique israélienne en Palestine... La seule inflexion, c’est peut-être d’avoir été plus ouvertement atlantiste, alors que chez Chirac, il y avait encore quelques vestiges d’antiaméricanisme gaullien, comme on l’avait vu au moment de la guerre d’Irak.
De ce que vous dites sur la continuité, on pourrait conclure que si un émule de Chirac avait été élu en 2007, la suite des événements aurait été la même ?
L’histoire alternative, celle qui s’écrit avec des « si », est une science problématique. Mais pour essayer de vous répondre, je vois deux points importants par lesquels Sarkozy et son entourage ont influé sur les événements qui ont abouti à l’écroulement de tout le système en 2011. Le premier point concerne la fin du socialisme, de la social-démocratie à la française. Sarkozy n’en a pas été la cause : ce qu’on appelait alors « la gauche » en France était très malade depuis longtemps. Sur toutes les élections de la Ve République, elle n’avait vraiment gagné, au fond, qu’une seule fois : en 1981. En 1988, la victoire n’avait été obtenue que grâce à la nullité du candidat Chirac, et elle avait été rapidement suivie par une longue période de cohabitation où Mitterrand n’était plus que l’ombre de lui-même. Et la victoire aux législatives de 1997 n’était qu’un accident consécutif à une dissolution suicidaire. Pendant la campagne électorale de 2007, la gauche n’avait plus rien à proposer. On a beaucoup dit, à l’époque, que Mme Royal avait mal mené son affaire, qu’un autre à sa place aurait pu gagner. Un supporter de Fabius a même écrit un livre qui avait pour titre Une élection imperdable, je ne me souviens plus de son nom...
C’était Claude Bartolone
Ah oui, c’est ça. Je pense qu’il avait tout à fait tort. Jusque là, c’était la droite qui empruntait des idées à la gauche : la « nouvelle société » de Chaban-Delmas, Premier ministre de Pompidou en 1969, la « fracture sociale » de Chirac en 1995... En 2007, c’était au contraire la candidate de la gauche qui en était réduite à reprendre des idées à son adversaire, sur fond de nationalisme et de surenchère sécuritaire. Dans ces conditions, c’était plutôt une élection ingagnable, à mon sens. Sarkozy n’a pas provoqué la déroute idéologique du Parti socialiste ni sa quasi disparition en tant qu’organisation politique. Mais il les a rendus évidents aux yeux de tous, par son opération de débauchage de personnalités socialistes de premier plan – vous vous souvenez de cette manœuvre, qui a commencé avec Kouchner et qui s’est poursuivie avec Strauss-Kahn, Lang et d’autres moindres seigneurs. Pendant des semaines, on s’est bousculé pour quitter le bateau. Sur le moment, tout le monde a salué l’habileté de l’opération. Personne n’a vu qu’il s’agissait d’une victoire à la Pyrrhus. Personne ou presque : parmi les esprits lucides, un philosophe par exemple, Alain Badiou, expliquait dès juillet 2007, dans une tribune du Monde, que ces élections marquaient la fin de l’après-guerre, du système droite-gauche si efficace dans le maintien du statu quo. Pour lui, il n’y avait désormais plus de choix qu’entre le ralliement réactionnaire et la lutte ouverte contre l’ordre établi. Et de fait, c’est bien l’autodestruction du rempart social-démocrate qui a ouvert la voie vers l’explosion de 2011.
Comment expliquez-vous que l’extrême gauche, les mouvements antilibéraux n’aient pas profité du boulevard qui s’offrait à eux ?
Ils étaient écartelés entre une phraséologie radicale et une pratique électoraliste. Et entre eux, il y avait trop de méfiance, trop de détestations historiques et personnelles pour qu’ils puissent s’unir et devenir crédibles. Mais au moment décisif, on les a retrouvés, pour une bonne part au moins de leurs militants.
Dans les médias des années 2007-2008, on parlait beaucoup de l’influence des « anarcho-autonomes ». Pensez-vous qu’ils aient joué un rôle important dans la préparation et le déroulement des événements de 2011 ?
Depuis que les Renseignements généraux ont été dissous et leurs archives ouvertes aux chercheurs, on sait que « les anarcho-autonomes » sont une pure création policière. Mais pour quelle raison ? C’est assez simple. La prolétarisation croissante de la petite bourgeoisie française grossissait les rangs de la jeunesse prête à en découdre, mais il n’existait plus aucun cadre traditionnel capable de la récupérer, étant donné l’unification de la classe politique en simple bouclier du système et la décomposition des organisations d’extrême gauche. Cette jeunesse a donc inventé ses propres pratiques politiques : les maisons collectives, le pillage, le sabotage, le graffiti, la manifestation sauvage, etc. On voit très bien ça dans le film de Gérard Gardenne, Montjoie-Saint-Denis et retour, aussi prémonitoire sur 2011 que l’avait été La Chinoise de Godard pour mai 1968. La police se devait de contenir la contagion de ces nouvelles formes d’action, et pour cela, elle a inventé un nouveau profil de la menace : les anarcho-autonomes. On a vu paraître opportunément toutes sortes d’articles et de reportages sur leur étrange mode de vie et leurs divers méfaits. En créant cette nouvelle catégorie, on cherchait à isoler de la population les rebelles nés dans son sein, à en faire des corps étrangers au lieu de les laisser s’y mouvoir comme des poissons dans l’eau, pour reprendre une vieille image maoïste. Les mouvements subversifs français ont su déjouer la manœuvre : ils n’ont pas repris à leur compte l’étiquette fatale d’autonomie, soit d’instinct, soit parce qu’ils avaient tiré les leçons de l’échec, dans les années 1970-1980, de l’autonomie italienne et de l’autonomie allemande.
Vous avez parlé d’Alain Badiou. N’était-il pas complètement isolé parmi ceux qu’on appelait « les intellectuels » ?
Pas tout à fait : parmi les écrivains, les philosophes et même les journalistes, il restait bien des gens qui n’avaient pas pris le virage à droite. Mais il est vrai qu’au moment de l’élection de Sarkozy, on a vu apparaître comme une évidence ce qui était jusque-là présent mais masqué : l’idéologie hégémonique de droite. La droite avait désormais ses intellectuels organiques, pour parler comme Gramsci, et beaucoup venaient des rangs de la gauche, anciens maoïstes, transfuges trotskistes, communistes repentis, syndicalistes reconvertis... Ils s’exprimaient avec la violence des renégats, en utilisant les artifices dialectiques de leurs organisations d’origine. Ils étaient puissants, ils contrôlaient l’enseignement de l’histoire et de la philosophie à l’université, ils avaient leurs revues, leurs blocs-notes dans des magazines, on les voyait sans cesse à la télévision, on les entendait tous les jours à France Culture, même avant sa privatisation. Mais là encore, c’était une soupape qui se fermait. Pour toute une partie de la jeunesse, il fallait autre chose que du néokantisme moisi ou de l’histoire écrite par les pires disciples de François Furet. C’est ce qui explique, dans les années 2007-2010, la multiplication de petits livres qui s’attaquaient avec violence à l’idéologie régnante et à ses conséquences directes sur les pauvres, les étrangers, les vieux, les jeunes, les chômeurs, les vulnérables de toutes sortes. Ces textes tournaient en ridicule les modes traditionnels de la contestation, les défilés pacifiques, les assemblées générales, les journées d’action. Ils manifestaient tout le mépris possible pour « la gauche », dont la disparition était ouvertement souhaitée. C’étaient des livres souvent rédigés par des collectifs, par des anonymes, et ils se diffusaient par le bouche-à-oreille. La presse n’en parlait jamais, mais leur influence a été déterminante pour les événements de 2011, même si l’on ne s’en est rendu compte qu’après-coup – un peu comme pour les textes situationnistes d’avant 1968.
Vous pensez donc que les causes de 2011 étaient essentiellement intellectuelles ?
Il est très difficile de classer par ordre d’importance les causes des grands événements. Prenez 1789, le déclenchement de la Révolution : quelles en ont été les causes essentielles ? Le travail de sape intellectuelle mené depuis au moins trente ans par ceux qu’on appelait les philosophes ? La banqueroute du trésor royal ? L’accord douanier qui ouvrait les portes au textile anglais ? La mauvaise moisson de 1788 ? Le caractère hésitant de Louis XVI ? Allez savoir. Mais pour 2011, il me semble en effet qu’il y a eu des causes profondes d’ordre à la fois intellectuel et moral. Ce qui m’amène au deuxième point où, selon moi, le sarkozysme a joué dans l’implosion du système : l’avènement du style cynique.
Comment faut-il l’entendre ?
Il y avait une expression, lancée je crois par Sarkozy lui-même et reprise ensuite par toutes les voix de la droite au pouvoir : « sans tabou ni complexe ». Ce n’était pas qu’ils soient tous devenus de fervents lecteurs de Freud. Ces mots avaient un sens précis : il ne faut pas avoir de scrupules à être riche, il n’y a rien de mal à gagner beaucoup d’argent, et il n’est pas honteux de le montrer. C’était une vraie rupture en France où jusque là, tous les politiciens sans exception prenaient garde, dans leurs costumes sombres, à paraître vertueux et désintéressés, à se tenir publiquement à l’écart du monde de l’argent. Même s’ils amassaient une fortune personnelle en utilisant leur position politique, et même si tout le monde le savait – ce qui avait été le cas pour Chaban-Delmas, pour Chirac – ils se gardaient bien de l’étaler. Si l’un d’eux était convaincu de manœuvres financières douteuses, c’était précisément un tabou qu’il brisait, et il était exclu du groupe dirigeant. Sarkozy ne possédait pas une très grande fortune personnelle, mais dès son élection, il a montré sa volonté d’en finir avec « les complexes » sur l’argent. C’est ainsi qu’il fallait interpréter le dîner au Fouquet’s le soir de son élection, son séjour à Malte sur le yacht d’un nabab ou ses vacances dans une villa pour milliardaires en Nouvelle-Angleterre. Il cherchait à importer en France les mœurs politiques de chez nous : le tutoiement et les claques dans le dos entre grands de ce monde, et le respect, voire l’admiration pour ceux qui se sont montrés capables de bâtir des fortunes. Un président de la République affichant publiquement ses liens avec les grands noms du monde médiatico-financier, c’était une grande première en France. Il était le parrain du fils aîné de celui-ci, le témoin de mariage de celui-là, il se disait « le frère » de tel autre, le « meilleur ami » d’un autre encore. Avant l’ère Sarkozy, ces gens-là – dont il faut rappeler les noms, aujourd’hui bien oubliés : Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, François Pinault, Serge Dassault – étaient déjà bien connus du grand public. N’importe qui savait qu’ils avaient la main sur la presse, l’édition, l’industrie d’armement, l’industrie du luxe, avec une position dominante sur la télévision et la radio. Mais Sarkozy a eu l’immense maladresse de montrer qu’ils constituaient en quelque sorte sa famille. Au temps du Front populaire, il y a presque un siècle, la presse de gauche parlait des « deux cents familles » qui possédaient la France. Sous Sarkozy, il n’y en avait plus qu’une seule. Ce n’était plus une oligarchie, c’était un clan, dont le président de la République était à la fois l’émanation et le chef. C’est cette situation que j’appelle le règne du style cynique. J’ai dans mes archives un numéro d’un magazine qui s’appelait Le Point, daté de juillet 2007. Sur la couverture, un grand titre : « Spécial riches ». C’aurait pu être une manchette de L’Humanité des années 1930, mais non : Le Point était un organe tranquillement de droite, qui avait fait campagne pour Sarkozy et soutenait son action. Un tel titre aurait été inconcevable avant l’ère Sarkozy, avant le triomphe du cynisme pur.
En quoi ce triomphe a-t-il influé sur la suite des événements ?
Si l’horizon économique était resté calme, le système aurait peut-être pu durer. Mais dans les années 2009-2010, c’est le monde entier qui s’est mis à tanguer. Chacun a en mémoire ces événements spectaculaires : les provinces chinoises secouées par des émeutes paysannes et ouvrières, le régime des généraux renversé en Algérie, l’Italie plongée dans le chaos après la répression sanglante à Naples, les prisons égyptiennes débordant de toutes parts suite à l’attentat raté contre le fils Moubarak, l’Amérique elle-même déchirée à propos de l’intervention militaire au Vénézuela, après la fin désastreuse de l’expédition irakienne. Sans parler de la tourmente économique qui a entraîné la dislocation de facto de l’Union européenne. En France, c’est, je pense, l’écroulement de l’empire Lagardère qui a sonné l’alarme. Arnaud Lagardère, empêtré dans l’affaire EADS, endetté jusqu’au cou par ses engagements dans les nouvelles technologies audiovisuelles et lâché par « son frère » Sarkozy, a été obligé de brader son groupe, comme autrefois Jean-Marie Messier lors de la déroute de Vivendi Universal. Les sous-traitants de Matra et d’EADS ont fait faillite en cascade, et des dizaines de milliers d’ouvriers se sont retrouvés au chômage. Le Monde, fleuron de la presse française, a dû être cédé à vil prix au groupe Murdoch. C’était un ébranlement sans précédent. Et – c’est là que j’en reviens au style cynique – il n’a pas été ressenti comme une épreuve collective à laquelle le peuple et son gouvernement devaient faire face, mais comme une trahison des riches qui allaient s’enfuir sur leurs yachts en laissant couler le bateau. Tous les témoignages le montrent, et même les médias les plus dociles s’en sont faits l’écho. En quelques semaines, l’image de Sarkozy s’est inversée : il n’était plus celui à qui tout réussit, il était devenu le responsable en chef du désastre.
Quels ont été pour vous les premiers craquements sérieux ?
Je pense que le tournant a été la grande grève des cheminots d’octobre 2009. C’était une grève « sauvage », comme vous dites en France, c’est-à-dire lancée sans aucune des autorisations préalables que prévoyait la loi et sans tenir compte des directions syndicales. Elle a démarré sur le réseau du Nord, pour obtenir la réintégration de deux conducteurs, licenciés pour avoir dénoncé publiquement le racisme et la brutalité de la direction. Mais très vite, elle s’est étendue à la France entière, y compris le RER : il ne s’agissait plus seulement de défendre deux collègues, mais d’en finir avec toutes les lois et décrets qui réduisaient à rien le droit de grève – le service minimum, la déclaration individuelle 48h avant toute grève, les votes à bulletins secrets sur la poursuite ou non d’un mouvement, toutes mesures si contraires à la tradition ouvrière française. Sarkozy a voulu faire avec les cheminots français ce que Margaret Thatcher avait réussi avec les mineurs anglais : il pensait qu’en brisant cette grève-là, il aurait la paix pour des années. Mais ce qu’il n’avait pas prévu, c’est l’appui massif que le mouvement allait recevoir : pour toute une partie de la population, c’était l’occasion de crier son rejet du sarkozysme. D’où les grandes manifestations de soutien dont plusieurs, comme à Rennes, se sont terminées par de violentes confrontations avec la police, des bâtiments publics incendiés, des gares ravagées. D’où aussi les collectes de fonds, les marchés improvisés où les paysans offraient leurs produits aux grévistes... A Rouen, où j’étais alors chargé de cours invité, les étudiants participaient aux piquets de grève qu’ils transformaient en forums de discussion. Ce qui était encore plus grave, c’est que les forces de l’ordre elles-mêmes semblaient vaciller. Dans la police, certains officiers avaient été relevés de leurs fonctions pour avoir ouvertement montré leur perplexité. Dans la région parisienne, le gouvernement avait mis en place un service de transports par camions et cars militaires. Un groupe d’officiers supérieurs a envoyé une lettre ouverte au ministre de la Défense, Patrick Devedjian : ils déclaraient que le rôle de l’armée était de défendre le pays contre les menaces extérieures et non de maintenir l’ordre intérieur et encore moins de briser les grèves. Sarkozy a fait émettre un ordre de réquisition des cheminots. Cet ordre est resté lettre morte et pour finir, au bout de trois semaines, le gouvernement a dû reculer. Pas complètement certes, mais la preuve était faite que ce pouvoir était vulnérable, qu’il pouvait être abattu. Quelques temps plus tard, il y a eu l’affaire de la petite Khadidja, morte en décembre 2010 au métro Barbès lors d’un gazage dans les couloirs par une équipe des GPSR. La manifestation de deuil s’est terminée en une mémorable émeute de tout l’Est parisien à laquelle participaient, selon les journaux télévisés, autant de gamins des cités que de jeunes des quartiers populaires de Paris, autant de chômeurs que de militants incontrôlés. Sarkozy a bien essayé d’exploiter l’événement comme il l’avait fait en novembre 2005 quand il était ministre de l’Intérieur, mais cette fois-ci, sa mise en scène d’une guerre entre les bons Français et la racaille des banlieues a tourné court : le contenu politique de la révolte ne pouvait plus être masqué.
Comment expliquer que Sarkozy, jusque-là si fin manœuvrier, n’ait pas vu venir le séisme de 2011, et qu’il ait ensuite réagi en alternant brutalité et hésitation ?
Il faut dire que la tâche n’était pas facile. Au printemps 2011, le pays tout entier était secoué en permanence par des grèves, des manifestations, des mouvements insurrectionnels brefs et violents menés par des chômeurs, des étudiants, des jeunes des quartiers. Petit à petit, ils s’organisaient, ils coordonnaient leurs actions. Les syndicats étaient débordés, plus personne ne les écoutait. Même les groupes les plus ancrés dans la soumission – les magistrats, les universitaires, les médecins – manifestaient leurs doutes, et pour certains leur hostilité au pouvoir. De toutes parts, on sentait le vent tourner. Pour rétablir la situation, il aurait fallu un geste spectaculaire, peut-être la démission du gouvernement et l’annonce d’élections anticipées... Au lieu de cela, il y a eu le discours télévisé menaçant de Sarkozy (« J’ai donné l’ordre aux préfets et aux autorités militaires de rétablir l’ordre républicain... »), l’instauration de l’état d’urgence, la nomination de Brice Hortefeux à l’Intérieur en remplacement de Martin Hirsch, toutes mesures qui n’ont fait qu’attiser la révolte. Si Sarkozy a été à ce point maladroit, c’est qu’il n’avait jamais eu à faire face à une situation grave. Des gens comme De Gaulle, et même comme Mitterrand, avaient vécu la guerre. Ils avaient dans leur entourage de vieux combattants qui savaient la musique. Sarkozy et les siens n’avaient connu jusque-là que le confort des banlieues résidentielles de l’Ouest parisien. Devant la dissémination de la révolte, ils ont pris peur, ce qui conduit comme vous le dites à se montrer tantôt brutal et tantôt hésitant. Le président, qui régentait tout quand tout allait bien, était, d’après les témoins, comme absent. Même si ce n’est pas lui qui a donné l’ordre de tirer sur la foule qui s’apprêtait à donner l’assaut à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, il a été tenu pour responsable du massacre. À partir de là, il ne pouvait plus tenir. Son départ précipité a signé la fin de la Ve République, en attendant l’écroulement du système capitaliste français.
Changement de propriétaire, la guerre civile continue,
Eric Hazan, octobre 2007, Seuil.
